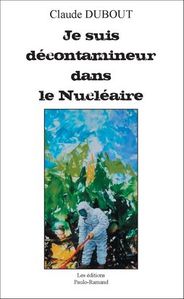Bernard Bigot : « Le nucléaire, une nécessité qui va demeurer »
MidiLibre.com (
http://www.midilibre.com/articles/2011/ ... 84092.php5) - vendredi 8 avril 2011
L'administrateur général du CEA évoque l'accident de la centrale japonaise de Fukushima et la priorité donnée à la sûreté nucléaire en France.
De passage à Montpellier, pour le colloque « Chimie pour le nucléaire du futur » organisé par le Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA), Areva et le Pôle Chimie Balard, Bernard Bigot, administrateur général du CEA, analyse la catastrophe de Fukushima et braque le projecteur sur la sûreté, pilier fondamental du programme nucléaire en France.
Vous revenez du Japon avec le chef de l’État, qui a proposé les services des experts français. Comment s'est passée la réunion avec le Premier ministre japonais ?
Le président de la République lui a dit sa confiance et lui a rappelé que Fukushima était un problème mondial, non strictement japonais. Il a mis à la disposition du gouvernement japonais l'expertise française, notamment dans le domaine du traitement des eaux contaminées, dont le centre de Marcoule s'est fait une spécialité.
Il lui a proposé également notre aide dans le domaine des scénarios de sortie de crise, de la robotique. Un discours très bien reçu. Naoto Kan a souligné que les conséquences de l'accident auront un impact durable, mais qu'il n'y avait pas de personnes suffisamment contaminées pour être hospitalisées en France. Il a accepté l'aide de la France.
Quelle est la nature de l'expertise française mise à la disposition des Japonais ?
Le CEA a développé des résines, qui capturent le césium et l'iode radioactifs en conditions hautement salines, c'est-à-dire dans l'eau de mer qui a servi à refroidir les réacteurs et les piscines de combustibles usés. Les données concernant ces résines (temps de synthèse, élaboration, cinétique, captation des zéolithes...) ont été envoyées au Japon pour évaluation et mise en œuvre.
En ce qui concerne la décontamination des sols, nous avons proposé des polymères, qui absorbent le matériel radioactif superficiel. De même, nous avons suggéré la phytoremédiation, avec des plantes qui accumulent les radionucléides dans leurs racines puis sont traitées pour élimination.
Enfin, au moment où M. Kan a accepté l'offre française, le président de la République lui a proposé cinq experts faisant partie de la délégation française. Le premier moment de surprise passé, les experts ont été intégrés immédiatement à la cellule de crise du gouvernement japonais.
Pourquoi les Japonais ont-ils mis tant de temps à accepter un appui extérieur ?
Je pense que les autorités japonaises ont cru pouvoir maîtriser seuls le problème. Elles ont été très imperméables aux offres d'entraide, même avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui leur avait proposé une telle coopération. A présent, ils ont vu qu'ils ne pouvaient s'en sortir seuls.
Quels sont les premiers retours d'expérience sur la catastrophe de Fukushima ?
D'abord, il faut souligner que les réacteurs en eux-mêmes et leurs bâtiments ont fait parfaitement preuve de leur robustesse par rapport au séisme initial, puis au tsunami qui a suivi. Les marges de sécurité – les réacteurs ont résisté à un séisme de magnitude 9 sur l'échelle ouverte de Richter, avec une accélération de 0,3 g, alors qu'ils avaient été calculés pour un magnitude 7 Richter – ont montré là leur pertinence. D'autre part, en examinant les données japonaises, il apparaît que l'accident nucléaire en lui-même était évitable.
Parleriez-vous de nouvelles négligences de Tepco, l'opérateur industriel des réacteurs ?
Non, même si certains faits antérieurs ne parlent pas en sa faveur. La robustesse face à des enjeux de sûreté repose sur un concept, mais aussi sur une organisation, une formation profonde des personnels, une compétence et une expertise. Il faut absolument préparer les acteurs locaux à réagir, à prendre les bonnes décisions au bon moment face à des événements exceptionnels.
Pouvez-vous nous donner un exemple prouvant ce manque de préparation ?
Au moment où les pompes, qui apportent l'eau de refroidissement aux réacteurs, ont été déstabilisées ou mises en panne par les effets du tsunami, les responsables sur place disposaient de 6 à 24 heures pour réagir. Au moment des événements naturels, les réacteurs se sont mis en sécurité automatiquement. Un réacteur à eau bouillante voit alors sa puissance thermique passer de 1 500 ou 2 000 MW (mégawatts, NDLR) à 3 MW en 12 heures. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus besoin que de lui apporter 3 m3 d'eau par heure pour le contrôler. Or, cela n'a pas été fait.
Il y a donc eu un empilement de causes et d'effets...
Exactement. Les combustibles usés ont besoin d'un refroidissement constant, sinon leur température monte jusqu'à 2 000°C. La vapeur d'eau est réduite (fractionnée, NDLR) par cette haute température en hydrogène et en oxydes métalliques en poudre. Ce qui donne des produits de fission gazeux, qui ont pollué l'atmosphère. Les Japonais ont ouvert volontairement des vannes de dégazage, alors que l'hydrogène s'accumulait dans l'atmosphère d'azote (gaz inerte, NDLR) du bâtiment réacteur.
Là, ils ont « oublié » que l'hydrogène est un gaz qui se diffuse par le moindre interstice et qui est très léger. Et lorsque ce gaz se concentre à 3 ou 4 %, il explose seul. Ce qui a entraîné l'explosion brisante du bâtiment 1, dont les débris ont endommagé gravement le bâtiment 3, qui a lui-même explosé plus tard. Ils n'avaient pas tiré les enseignements du bâtiment 1.
Que diriez-vous des jours qui vont venir à Fukushima ?
Je dirais que je suis raisonnablement, prudemment optimiste.
La France compte 58 réacteurs en exploitation. Que répondez-vous aux écologistes, qui exigent de sortir du nucléaire ?
On ne fait pas du nucléaire par plaisir, mais pas nécessité. Et les raisons qui ont amené au développement du nucléaire en France et dans le monde n'ont pas été modifiées depuis Fukushima.
L'une des principales est la dépendance en matière de fourniture énergétique. En 2003, la facture en pétrole de la France était de 23 milliards d'euros, ce qui veut dire que chaque Français travaillait 19 jours pour que notre pays puisse payer son pétrole. En 2008, lorsque le baril est monté jusqu'à 147 dollars le baril, la facture est montée à 52 milliards d'euros : chaque Français a dû travailler 58 jours pour l'acquitter, c'est-à-dire 25 % de son temps de travail !
Le prix en est donc insupportable, de même que pour le risque climatique, alors que ces ressources fossiles sont limitées dans le temps. Et dans les 20 ou 30 prochaines années, bien d'autres pays seront confrontés à ce choix.
N'y aurait-il donc aucune ouverture possible vers les énergies dites renouvelables ?
Nos sociétés ont besoin d'un moyen de production massif d'électricité pour permettre le développement des énergies renouvelables. Le CEA investit une part de plus en plus importante de son budget dans la recherche et développement de ces autres énergies. Le gros problème est leur intermittence, par comparaison avec la permanence de la production nucléaire.
Le solaire ne fournit de l'électricité que durant 20 % de son temps et l'éolien 25 %. A cet égard, examinons l'exemple allemand. L'Allemagne dispose de 30 000 éoliennes, dont beaucoup offshore (au large des côtes, NDLR). Si l'on coupait les centrales nucléaires et autres (fioul, charbon), en cas de black-out comme il est advenu parfois aux Etats-Unis, il faudrait 3 semaines pour les reconnecter aux réseaux ! (1)
Et que faire pendant ce temps ? L'espoir réside tout de même dans une rupture technologique majeure, qui permettrait de résoudre le problème immense du stockage de l'électricité.
Est-ce à dire que l'avenir ne peut être pavé que de réacteurs nucléaires, avec la Génération III en construction (EPR) et la Génération IV après le milieu de ce siècle (sodium, très haute température, sels fondus, gaz...) ?
Quand la population humaine se montait à un milliard d'habitant – il n'y a pas si longtemps, c'était en 1850 –, la biomasse (bois, charbon) et la production alimentaire locales suffisaient amplement à assurer tous les besoins. Avec 7 milliards d'êtres humains et bientôt 9 milliards dans peu de décennies, la solution ne se conçoit que dans des moyens de production massifs, que ce soit en énergie, en alimentation, en industrie.
Pourtant, selon les écologistes, le nucléaire est frappé au sceau du risque maximal ?
Il n'existe pas de technologie sans risque zéro. Le risque minimal, donc la sûreté, provient de la conception, ainsi que de la formation des hommes qui assument ces responsabilités. Pour revenir à Fukushima, il faut disposer d'organisations robustes, avec des décideurs très bien formés et des moyens prépositionnés. Nous travaillons justement sur le prépositionnement, bien en dehors des enceintes nucléaires, de moyens (eau, électricité par générateurs) qui nous permettront de réagir aux urgences, qu'elles soient naturelles ou artificielles. De plus, il faut former encore mieux les ingénieurs et techniciens, un peu comme dans les programmes d'entraînement intensifs sportifs.
Disposons-nous en France de cette sûreté ?
Chaque année, une dizaine d'exercices (terrorisme, accidents naturels ou artificiels), aux scénarios inconnus des acteurs, sont diligentés en France, sans compter deux milliers de contrôles exercés par l'Autorité de sûreté nucléaire. La sûreté est le pilier fondamental de l'activité nucléaire, c'est un impératif absolu. Nous ne faisons pas du nucléaire par plaisir, mais par nécessité.
Propos recueillis par PHILIPPE DAGNEAUX
pdagneaux@midilibre.com